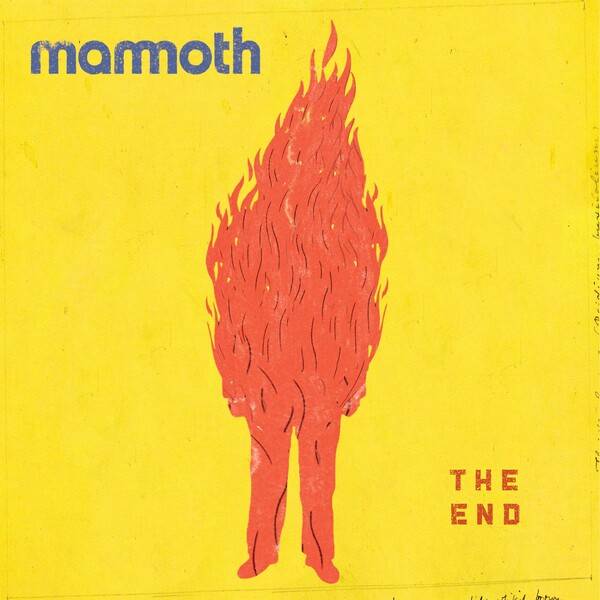L’autre jour, alors que j’essayais de me faire une idée au casque du dernier album en date des Black Angels, j’étais surpris par le caractère terne de leur son, une constatation qui ne cadrait pas vraiment avec le souvenir que je me faisais du mur de cordes et de réverb’ qui noyait leurs précédentes réalisations. Oui vraiment, quelque chose ne tournait pas rond. C’est alors que je me suis aperçu que mon connecteur était mal embranché sur mes écouteurs. Une fois rectifiée l’anomalie, me voilà de nouveau gratifié d’un spectre sonore bien plus en adéquation avec le psyché heavy entêtant des Anges Noirs, même si leur Chanson de la Mort ne m’a pas forcément séduit autant que leurs émoluments passés. De fait, ce réajustement a fait réapparaître dans mon casque un instrument qui pourrait passer pour anecdotique mais qui, en l’occurrence, change souvent tout dans un spectre sonore, je veux parler de la basse. Et autant vous le dire tout de go : sans basse, les Black Angels ne valent pas tripette.

Pourtant, pour paraphraser un certain Brice de Nice, la basse, au goût de trop nombreuses personnes, “c’est comme le H de Hawaï : ça sert à rien”, un axiome surtout vrai durant la décennie précédente qui a fait la part belle au duo rock garage guitare-batterie à la Kills, White Stripes ou Black Keys. Ainsi débarrassé de tout son superflu (quatre cordes comprise), le rock n’ roll était sensé retrouver toute sa fraîcheur, sa violence, sa raucité. Ailleurs, il n’y aurait pas de bassiste que l’on ne s’en rendrait même pas compte, mettons dans un même grand sac la scène heavy metal en général - et Metallica en particulier, du moins après l’ère Cliff Burton -, même si, évidemment (j’en vois déjà pousser des cris d’orfraie), de nombreuses exceptions existent. N’empêche. Pour tout un pan du rock, la basse n’apporte pas grand chose, soit qu’elle ne s’entende pas, soit qu’elle soit sous-exploitée, soit que ceux qui s’y adonnent n’arrivent pas à tirer suffisamment de matière de leur instrument pour améliorer le rendu sonore voire le jeu d’ensemble de leur groupe. Et les types qui s’y adonnent ne font souvent pas montre d’un charisme débordant (souvent, car là encore, les exceptions sont légion). Classiquement, le bassiste, c’est le gars cool dans le groupe, effacé, peu disert, discret, limite dépressif... quand le poste ne se réduit pas carrément à une vulgaire caution féminine. C’est bien simple : lorsqu’il y a une femme dans un groupe de mecs, neuf fois sur dix, c’est à la basse qu’on la “tolère”. Dingue de voir ce qu’il y a comme femmes dans la profession, une remarque qui n’a vraiment, mais alors vraiment rien de péjoratif et qui se limite à une simple constatation, un peu triste aussi. Plus largement, faites le test auprès de vos amis et essayez de leur faire deviner les noms de tous les membres de, allez, 10 groupes de rock de votre choix. Vous verrez : celui qui sera le moins souvent identifié, ce sera le bassiste. C’en est arrivé à un tel stade que les deux béarnais de The Inspector Cluzo, qui ont eux aussi décidé de céder à la mode blues rock garage et de suivre les traces de Dan Auerbach & Patrick Carney, ont appelé leur second album Fuck The Bass Player et leur label Fuck The Bass Player Records - je ne vous traduis pas, vous avez tous compris. Face à ce triste constat, il est grand temps de venir à la rescousse des bassistes.

Commençons déjà par remettre les choses à leur place : les bassistes ont peut-être, sans doute même, une part de responsabilité dans ce qui leur arrive pour n’avoir pas su imposer leur instrument comme pierre angulaire indispensable du rock n’ roll. Et il y a tant de moyens de le faire. D’une part, la basse est un instrument rythmique, elle participe au groove, à la pulsation, à l’énergie de la musique jouée, et lorsque cet aspect se voit sublimé, il débouche sur des lignes hors pairs qui transcendent et électrisent les morceaux, et ce n’est pas Flea qui me contredira. D’autre part, la basse tient aussi un rôle mélodique, héritant en cela la place de la contrebasse dans les formations populaires plus traditionnelles. Les partitions de basses peuvent, et même doivent réaliser le meilleur contrepoint possible au motif principal, qu’il soit apporté au chant ou à la gratte, quand elles ne doivent pas s’emparer (de force s’il le faut) des éléments mélodiques principaux, et ce n’est pas Kim Deal ni Peter Hook qui me contrediront. Oui, un bassiste peut et même doit jouer de la musique, pas simplement se contenter d’un paresseux doom doo-doom doom doom doooom monocorde planqué au fond de la scène derrière les cymbales, et oui, un bassiste peut et même doit interpréter des soli sur son instrument comme le font régulièrement ses pairs guitaristes et batteurs.

Notez que la plus-value pour une formation qui accueille un individu répondant aux critères ci-dessus est évidente : un groupe possédant un grand bassiste est automatiquement un grand groupe (la réciproque n’étant pas acquise, loin de là). Et les exemples surabondent : Cream (Jake Bruce), Rush (Geddy Lee), The Who (John Entwistle), Led Zeppelin (John Paul Jones), les Red Hot Chili Peppers (Flea), Black Sabbath (Geezer Butler), Primus (Les Claypool), Chris Wolstenholme (Muse). Et que seraient devenus les Beatles sans la patte inimitable de Paul McCartney à son instrument, indépendamment de son phénoménal don de songwriting ? Certes, on me soutiendra que les autres membres des formations en question sont également de bons techniciens, n’empêche : sans un “quatrième homme” valable, on doute qu’elles eussent toutes connu un tel succès. À l’inverse, combien de bons groupes ont-ils flanché, artistiquement du moins, après avoir perdu leur (excellent) bassiste ? Allez, d’autres exemples : Metallica à la mort de Cliff Burton, Interpol après le départ de Carlos Dengler, Pink Floyd lorsque Roger Waters s’en est allé, Queens Of The Stone Age après que Nick Oliveri se soit fait dégager… Dès lors que l’instrumentiste en question ne se montre pas interchangeable, qu’il apporte à l’effectif une personnalité, un style, une attitude, sa perte peut provoquer un grand vide.

Or trop souvent voit-on des bassistes “par défaut” au sein d’un effectif de rock, phénomène gagnant de plus en plus d’essor depuis la fin des années 70, époque où laquelle une telle notion frisait l'hérésie pure et simple. Là encore, les exemples courent les rues. Duff McKagan, à la base, est guitariste - il était quand même l’une des deux chevilles ouvrières du groupe pré grunge Ten Minute Warnings - et avoue volontiers qu’aux débuts des Guns N’ Roses, il savait à peine jouer de son instrument. Idem pour Andy Bell qui est allé cachetonner à la quatre cordes chez Oasis mais qui est quand même le guitariste de Ride. En fait, bien souvent lorsqu’un groupe se forme, la question du bassiste se pose à la dernière minute : tiens, il nous manque quelqu’un. Ainsi les Pixies qui comblent ce poste via petite annonce avec le recrutement de Kim Deal, ou Black Sabbath qui confie ce job à Geezer Butler faute de mieux. Là encore, pour les deux exemples pré-cités, nous avons affaire à deux guitaristes de formation, même s’ils auront su au sein de leurs groupes respectifs imposer leur jeu et leur singularité grâce à leur nouvel instrument. Ce phénomène, beaucoup trop fréquent, explique sans doute pourquoi il y a si peu de bassistes de rock dans le classement des “100 meilleurs bassistes de tous les temps” tout récemment établi par le magazine Bass Player.

D’autant que les bassistes n’ont pas à apporter qu’une singularité technique, une assise rythmique ou un appui mélodique, ils peuvent aussi (et doivent souvent) contribuer à façonner le son du groupe auxquels ils appartiennent. On a trop souvent tendance à réduire le son de Black Sabbath au seul Tony Iommi (avec son accident, ses phalanges tranchées, ses cordes détendues, son détunage etc), mais ce serait oublier l’importance que Geezer Butler déploie dans l’édification du mur Sabbathien, et le guitariste le reconnaît d’ailleurs lui-même. On peine ainsi à comprendre comment 90 % des formations de heavy metal à la louche peuvent à ce point négliger leur bassiste. Citez-moi un type ne serait-ce que capable et ostensiblement mis en avant dans ce domaine, Cliff Burton et Steve Harris mis à part… les clients ne sont pas légion, et ce n’est certes pas Rob Trujillo, malgré son slapping mémorable lorsqu’il officiait chez Suicidal Tendencies, qui relève actuellement la barre. Vous l’entendez sur Hardwired… To Self Destruct, vous ? Pas moi. Certains groupes de metal progressif s’appuient certes sur cet instrument, mais il s’agit là de l’exception qui confirme la règle : Tool en est l’exemple le plus caractéristique (avec Justin Chancellor), et Dream Theater le contre-exemple le plus caricatural (avec ce pauvre John Myung qui, malgré sa technique redoutable, n’a pas voix au chapitre sonore). En ce sens, le grunge a certainement mieux appris la leçon sabbathienne de Butler que tous les héritiers soi disant officiels du Sab. Heureux sont-ils, les Novoselic, Ament, Shepherd et Inez. D’une façon générale, certains pans du rock ont tout avantage à s’appuyer sur la basse : le rock psyché heavy (des Black Angels, par exemple), le progressif (de Rush par exemple), le funk-metal / rap-metal (des Red Hots par exemple, mais aussi de Rage Against The Machine), la cold wave (Joy Division et globalement tous ses successeurs) et bien sûr toutes les pop un tant soit peu dansantes, mais dans ce dernier cas on quitte clairement le domaine du son. Globalement, gageons que le rock aurait vraiment tout à gagner à s’appuyer sur des bassistes de formation, pas seulement sur des guitaristes perdus ou ratés, des types maîtres de leur instrument et qui savent parfaitement l’insérer dans la musique de leur groupe.
Et peut-être la donne pourrait-elle changer ? Le garage à la White Stripes - Black Keys a quand même pris du plomb dans l'aile, Jack White s’entourant désormais de bassistes pour sa carrière solo et les Black Keys ayant depuis longtemps renoncé à s’en passer (rien que sur “Fever”, c’est la basse qui fait tout le boulot). Et si les frontmen bassistes demeurent rares - Roger Waters après son putsch chez Pink Floyd, Lemmy chez Motörhead, Geddy Lee chez Rush, Sting chez Police, Mariusz Duda chez Riverside… il ne doit pas y en avoir beaucoup plus -, il faut tout de même signaler un contre-exemple assez remarquable : Royal Blood. Mike Kerr a su retourner à son avantage le concept du duo guitare-batterie pour recycler l’idée géniale des non moins géniaux Death From Above 1979 : éjecter la six cordes et ne conserver que la quatre tout en s’accaparant le micro. Lui et son collègue Ben Thatcher ont ainsi pu, grâce à cette formule heavy décapante, redonner en 2014 un vrai coup de fouet à un rock anglais moribond depuis le début de la décennie et imposer la basse comme authentique instrument rock n’ roll. Et ça tombe bien : les deux hommes reviennent avec un deuxième album forcément très attendu dans un peu moins d’un mois. Fuck the bass player? N’en déplaise aux Cluzo, on gage à l’inverse que Mike Kerr saura susciter de nombreuses vocations et que les intéressés conserveront le plus longtemps possible leur virginité anale.