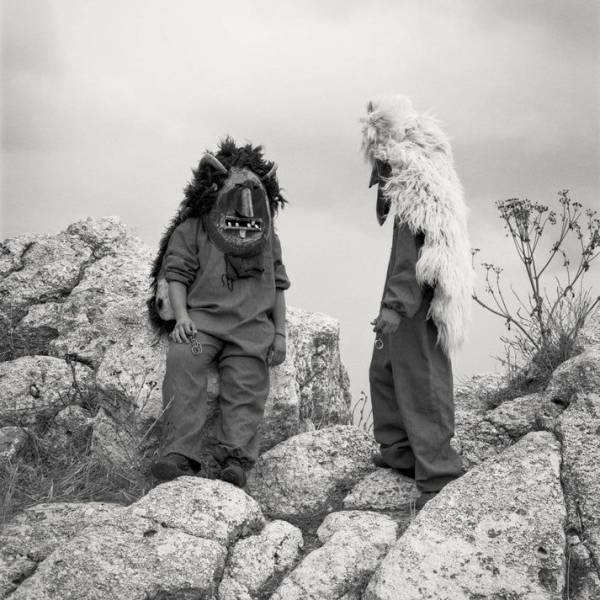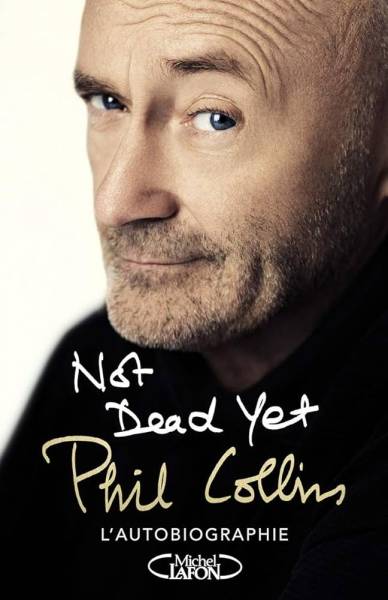Le documentaire De Rockstar à tueur : le cas Cantat, disponible sur Netflix depuis le 27 Mars, se donne pour objectif d’apporter un nouveau regard sur le meurtre de Marie Trintignant en s’appuyant notamment sur une analyse critique des différentes lignes de défense de Bertrand Cantat et de leur traitement médiatique. Une réussite encourageante qui s’attarde également sur des événements ayant suivi la libération conditionnelle du chanteur en 2007, moins connus du grand public mais tout aussi préoccupants.
L’affaire vous est déjà probablement bien familière : dans la nuit du 26 au 27 juillet 2003, Marie Trintignant est retrouvée inconsciente dans une chambre d’hôtel à Vilnius après une dispute avec son compagnon de l’époque et célèbre leader de Noir Désir Bertrand Cantat. Elle décède quelques jours plus tard à Neuilly-sur-Seine, ne pouvant être sauvée d’un œdème cérébral puis d’un coma profond résultant de tous les coups portés. Le drame émeut le pays avant de le diviser, à la découverte du rapport d'autopsie qui provoque différents changements de version de la part du chanteur et la requalification de l’acte par la justice lituanienne d’accident en meurtre. Bertrand Cantat est finalement condamné à 8 ans de prison ferme pour “meurtre commis en cas d’intention indirecte indéterminée” avant de bénéficier d’une liberté conditionnelle fin 2007, qui lui permettra de reprendre ses activités musicales avec pour contrainte de ne pas adresser publiquement le sujet du meurtre.
Divisée en trois épisodes de 40 minutes dans un format désormais typique de Netflix, cette mini-série qui revient sur l’affaire après plus de 20 ans se révèle être une bonne surprise malgré son titre un peu sommaire : on peut s’attendre à un sensationnalisme déplacé au regard du thème choisi et de la fascination morbide pour les portraits criminels déjà bien exploitée sans trop de considérations par la plateforme – mais le documentaire évite globalement cet écueil en se focalisant sur le point de vue reconstruit des victimes et les différentes logiques qui ont façonné leur traitement médiatique. On y trouve ainsi un large panel de témoignages brassant des rôles très variés, d’acteurs de l’industrie musicale proches de Noir Désir (dont l’ex-tourneur du groupe et l’ex-président d’Universal Pascal Nègre) à l’entourage étendu de Marie Trintignant (comme la chanteuse Lio ou son ex-compagnon et batteur de Téléphone Richard Kolinka) en passant par le personnel de tournage, les juges, les officiers de police, le médecin légiste et les journalistes ayant contribué à la couverture des évènements en 2003 ou bien plus tard.
Tout ce corpus de personnalités, mêlé à des archives vidéo parfois inédites pour le grand public, permet d’établir dans le premier épisode un récit assez précis de la relation entretenue entre les deux amants, avec un leader de Noir Désir qui apparaît dans les dernières semaines à Vilnius comme possessif, paranoïaque et manipulateur avant même toute manifestation remarquée ou supposée de violence physique. Le second épisode est probablement le plus consistant des trois en ce qu’il dresse un état des lieux édifiant des différents récits qui ont été développés dans les médias en amont du procès, une fois la thèse de la “chute accidentelle sur un radiateur” écartée par le rapport d’autopsie. Dans une tentative d’expliquer voire d’excuser les 19 coups portés sur l’actrice, on constate une complaisance collective envers le musicien bordelais souvent présenté en victime face à une Marie Trintignant jugée “instable”, “hystérique”, “déséquilibrée”, les journalistes reprenant à leur compte le vocabulaire de Cantat et de son avocat. On explore enfin l’histoire dramatique de Krisztina Rady, épouse de Bertrand Cantat et mère de ses deux enfants, qui devient le sujet principal d’un dernier épisode glaçant détaillant le retour de son mari dans la cellule familiale – révélant ainsi qu’il n’y a pas une seule affaire Cantat, mais bien plusieurs. La femme de lettres franco-hongroise y est dépeinte à bout de souffle, ne trouvant pas les armes pour se sortir de l’emprise d’un mari aux comportements de plus en plus dangereux, ce même mari qu’elle a pourtant protégé durant son procès en dépit de violences avérées avant la séparation. Elle finit par se donner la mort en 2010 alors que Cantat dort dans la pièce d’à côté. Nous sommes des années avant la promulgation de la loi sur le suicide forcé qui s’applique principalement à des cas de violences conjugales de ce genre : aucune enquête n’est alors poursuivie par la police une fois le suicide par pendaison attesté.
En plus d’une retranscription très complète des événements à partir de Vilnius, le documentaire déroule avec justesse les différents mécanismes qui s’opèrent derrière les violences conjugales en montrant notamment que le caractère jugé exceptionnel, démesuré de la première affaire est surtout lié à la popularité des personnalités concernées : les agissements de Cantat et les faits ayant fait exploser sa jalousie correspondent finalement à un profil type de conjoint violent, dépassant le monde des célébrités et encore valable aujourd’hui. Cette identification est facilitée par l'intervention de quelques invité·e·s qui dressent des parallèles difficiles avec leurs vécus personnels ("Tu vas finir comme Marie Trintignant" réalise la journaliste Michèle Fines avant de s'enfuir d'une relation similaire). Puisque certains comportements dangereux se reproduisent à la sortie de prison, nous sommes également confrontés aux différents échecs de la société française face aux violences sexuelles et sexistes, qui peine à comprendre sur le moment ce qui se joue derrière les actes et la victimisation réussie de Bertrand Cantat. La responsabilité des institutions policières ou judiciaires est régulièrement discutée au fil des trois épisodes, notamment pour certaines démonstrations d’incompétence ou d’inconscience – comme celle d’encourager l’auteur d’un féminicide à retourner vivre avec son ex-femme dans le cadre de sa liberté conditionnelle, qui mènera à l’issue que l’on connait.
Ce même terme de féminicide ne fait d’ailleurs jamais partie des discussions publiques de l’époque puisqu’il ne rentre vraiment dans le sens commun qu’à partir du mouvement #metoo en 2016, et le meurtre de Marie Trintignant y est donc seulement analysé en fait isolé sans y reconnaitre d’enjeu politique global. Le concept de “crime passionnel” caduque en France depuis 1975 est à l’inverse largement mis en avant sur les plateaux, avec de nombreux ouvrages sur le sujet promus à heure de grande écoute et peu d’invités questionnant le fondement absurde de cette idée. La critique des médias occupe alors une place essentielle dans le documentaire : revoir tout ce défilé de pseudo-intellectuels légitimer le principe du meurtre passionnel dans le but d’estomper la culpabilité de Cantat donne le vertige et force le spectateur à se questionner, déjà sur des problématiques de fabrique des opinions ou d’entre-soi médiatique, ensuite sur le sexisme structurel et parfois intériorisé qui abaisse le degré de vigilance général de la société.
Au delà de quelques témoignages hors-sol en dissonance évidente avec le reste du propos (comme souvent, on peine beaucoup devant les interventions de Pascal Nègre), il apparaît clairement que la réalisation avait à cœur de mettre au premier plan toute la souffrance causée par les agissements de Cantat au dépend de son histoire personnelle, déjà bien trop racontée par les journaux français dans un registre souvent plaintif ou compassionnel. Mais peut-être que l’on passe un peu trop brièvement sur son retour sur scène et en studio qui renforce définitivement l’indécence et la lâcheté de sa position, avec de nombreuses collaborations de premier plan auprès d’artistes reconnus ou dans l’air du temps (Eiffel, Amadou et Mariam, Shaka Ponk), un nouvel album sous le nom de Detroit globalement bien accueilli par le public mais qui ose cacher des réflexions pénibles sur ses actes derrière de la petite poésie (“Ange de désolation”, inécoutable), et un dernier projet cette fois-ci en son nom propre, avec sa silhouette bien reconnaissable en couverture : tout un symbole. Le documentaire survole un peu les conditions favorisant le retour en force de Cantat tout comme l’absence de gène de ce dernier, manquant ainsi l’opportunité d’adresser plus frontalement la question de l'impunité des artistes relativement aux violences sexuelles et sexistes, loin de lui être spécifique et qui reste encore aujourd’hui un sujet de société brûlant (à voir le traitement du procès en cours de Gérard Depardieu). On nous présente par exemple la fameuse une des Inrockuptibles de 2017 en questionnant bien évidemment l’empathie déplacée de l’interview qui évite au passage toute mention de Marie Trintignant ou de Krisztina Rady, mais sans s’attarder réellement sur la philosophie du magazine l’ayant encouragé dans cette direction, les rapports étroits avec le groupe Noir Désir depuis leurs premiers numéros et leur affligeant message d’excuse révélant une profonde dissonance cognitive sur leur engagement contre le sexisme.
Il est pourtant difficile de ne pas être gêné quand l’un des invités du documentaire invoque la nécessité de séparer un artiste de son œuvre pour justifier les succès ultérieurs du musicien. Surtout lorsque le simple fait de chanter lui-même ses propres textes place en définitive Bertrand Cantat au centre de la création, que sa personnalité publique faite de combats politiques a toujours fortement imprégné son œuvre, qu’il est évident que son écriture est à minima influencée par ses propres crimes et la manière dont il les a intériorisé. Chaque position d’influence dans la société incombe une certaine responsabilité et l’idée de dissocier un artiste de ses crimes, en plus de manquer de sensibilité (et d’aller ici à l’encore de la logique de l’artiste lui-même), n’a donc pas de sens pour une personnalité publique devenue de son propre fait le symbole douloureux des violences domestiques.
Il ne s’agit pas de s’acharner sur un homme désormais en retrait de la vie médiatique mais bien de réaliser en quoi le cas de Bertrand Cantat est symptomatique de notre difficulté à traiter collectivement les cas de violences conjugales et donc de féminicides. Pour preuve, les premières réactions sur les réseaux sociaux autour de la série ne se sont pas montrées accueillantes, indépendamment du résultat final. Rien de tout cela n’a sa place tant le documentaire ne laisse aucun doute quant au déroulé des évènements et dresse un portrait empathique, respectueux des deux victimes Marie Trintignant et Krisztina Rady. Parfois difficile à regarder à cause de la cruauté de ses faits, De Rockstar à tueur : le cas Cantat réussit à apporter un nouvel éclairage sur des événements pourtant déjà beaucoup racontés, sans les romantiser et sans les alléger malgré un format plutôt court et un public cible probablement très large. Une réussite indéniable donc, et un visionnage plus que recommandé quel que soit le degré de connaissance du sujet.