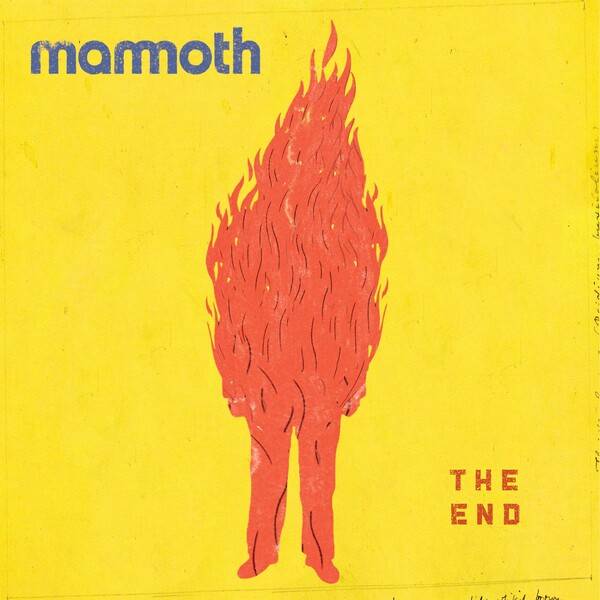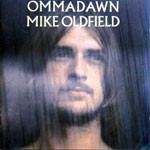Steven Wilson : l'homme qui se cache derrière Porcupine Tree
- Introduction
- 1982 - 1996 : Un début de carrière prometteur
- 1996 - 2009 : la consécration d'un grand musicien
- Derrière Porcupine Tree, une discographie riche mais méconnue
- Steven Wilson : une certaine conception du rock
- Discographie
1982 - 1996 : Un début de carrière prometteur
3 novembre 1967 : naissance
 Commençons par le commencement. Steven Wilson voit le jour le 3 novembre 1967, à Hemel Hempstead en Angleterre, ville située dans la proche banlieue de Londres dans laquelle il passera son enfance. Bercé par la culture musicale de ses parents, le petit Steven se voit pendant un temps contraint d'apprendre la guitare. Mais l'expérience ne durera pas. L'enfant trouvant l'instrument trop rébarbatif, ses parents ne pousseront pas l'apprentissage outre-mesure. Et c'est à l'âge de huit ou neuf ans que Steven connaîtra son premier choc musical par le biais de deux des disques qui passaient alors en boucle chez lui : The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd, et Love To Love You Baby de Donna Summer. Sans trop le savoir, c'est de ces deux vinyles qu'il puisera par la suite une bonne part de sa créativité. Empruntant au premier son goût du rock progressif (Porcupine Tree) et à l'autre ses rythmes pop et son groove (No-Man).
Commençons par le commencement. Steven Wilson voit le jour le 3 novembre 1967, à Hemel Hempstead en Angleterre, ville située dans la proche banlieue de Londres dans laquelle il passera son enfance. Bercé par la culture musicale de ses parents, le petit Steven se voit pendant un temps contraint d'apprendre la guitare. Mais l'expérience ne durera pas. L'enfant trouvant l'instrument trop rébarbatif, ses parents ne pousseront pas l'apprentissage outre-mesure. Et c'est à l'âge de huit ou neuf ans que Steven connaîtra son premier choc musical par le biais de deux des disques qui passaient alors en boucle chez lui : The Dark Side Of The Moon de Pink Floyd, et Love To Love You Baby de Donna Summer. Sans trop le savoir, c'est de ces deux vinyles qu'il puisera par la suite une bonne part de sa créativité. Empruntant au premier son goût du rock progressif (Porcupine Tree) et à l'autre ses rythmes pop et son groove (No-Man). A l'âge de onze ans, Steven remet la main sur une vieille guitare acoustique et recommence sa formation mais cette fois fois-ci en autodidacte, explorant le panel de sonorités qu'il peut en sortir en frottant différents objets sur les cordes nylons avant d'enregistrer le tout sur un enregistreur cassette multicanal, appareil offert par un père ingénieur électronicien et féru de technologie. Petit à petit, sa passion pour les expérimentations sonores se fait telle que sa chambre se transforme en véritable studio d'enregistrement et de production. Le No-Man's Land était né, et celui-ci reste encore aujourd'hui en activité.
1982 : Altamont et Karma

La deuxième de ces formations (Karma) permettra avant tout à Steven de goûter un peu à la scène. Né en 1982, le groupe sortira deux cassettes sur le label Acid Tapes : The Joke's On You en 1983 et The Last Man To Laugh en 1985 et sur laquelle Steven Wilson commencera à écrire ses propres textes. Donnant dans un rock progressif assez indigeste, le groupe, tout comme Altamont, se séparera peu de temps après. Cependant, certains morceaux referont surface quelques temps après sous la houlette de Porcupine Tree, et notamment "Nine Cats" sur l'album On the Sunday of Life et "Small Fish" sur Up The Downstairs.
1986 - No Man

Sous l'influence de Wilson, qui souhaite explorer le côté pop de ses penchants musicaux, No-Man passe d'un registre psychédélique-progressif à une tonalité pop-dance qui caractérise le style initial des deux premiers albums. Le premier, Loveblows And Lovecries : A Confession, paraît en 1993 après une longue phase parsemée de démos et d'EP en tous genres, et notamment Speak, période couronnée en 1992 par une tournée en première partie d'Ultravox. Le côté électro et remuant des titres qui se trouvent sur ce disque assure une certaine renommée au groupe. Mais très vite Bowness et Wilson émettent des réserves sur la tournure que prend le groupe et l'engouement qui se crée autour d'eux et qui est alors perçu comme une forme de contrainte. A choisir entre succès facile et musique plus atypique et expérimentale, les deux leaders décident d'emprunter la seconde voie. Moins d'un an plus tard sort donc Flowermouth, considéré par beaucoup comme le meilleur album de No-Man, beaucoup moins formaté, très varié et alternant titres orientés pop-électroniques, ambiances plus acoustiques, sonorités atmosphériques et trip-hop. Pour la première fois, le groupe s'adjoint de nombreux musiciens invités, parmi lesquels Robert Fripp (King Crimson) ou Lisa Gerrard (Dead Can Dance), une habitude qui sera répétée sur chaque réalisation future. Malgré le relatif succès de ce disque, le label de No-Man (One Little India) les lâche car craignant la tournure expérimentale que prend la musique du groupe. Et comme un mal n'arrive jamais seul, Coleman quitte l'esquif et laisse Bowness et Wilson réduits à deux...
1987 - Porcupine Tree
 A la fin des années 80, et toujours au sein de son No-Man's Land, Wilson commence à enregistrer quelques maquettes dans un registre nettement plus expérimental et progressif, en profitant pour ressortir les textes de son ami Alan Duffy qu'il avait déjà exploité au temps d'Altamont et de Karma. Eternel insatisfait face à ses parties vocales, Steven noie sans cesse sa voix sous des montagnes d'effets, et fait de temps en temps appel à son ami Malcolm Stocks pour venir poser quelques parties de guitare. Décidant de tourner cette collaboration sous forme de blague, les deux compères décident de créer de toute pièce un groupe nommé IEM (Incredible Expanding Mindfuck), allant jusqu'à rédiger une biographie retraçant pour l'occasion les personnalités ayant participé à l'aventure depuis les années 70 ainsi que quelques passages dans des concerts rock tout aussi imaginaires. Et dans la foulée, Malcolm et Steven s'invitèrent dans la formation sous les noms respectifs de Solomon St Jermain et de Porcupine Tree.
A la fin des années 80, et toujours au sein de son No-Man's Land, Wilson commence à enregistrer quelques maquettes dans un registre nettement plus expérimental et progressif, en profitant pour ressortir les textes de son ami Alan Duffy qu'il avait déjà exploité au temps d'Altamont et de Karma. Eternel insatisfait face à ses parties vocales, Steven noie sans cesse sa voix sous des montagnes d'effets, et fait de temps en temps appel à son ami Malcolm Stocks pour venir poser quelques parties de guitare. Décidant de tourner cette collaboration sous forme de blague, les deux compères décident de créer de toute pièce un groupe nommé IEM (Incredible Expanding Mindfuck), allant jusqu'à rédiger une biographie retraçant pour l'occasion les personnalités ayant participé à l'aventure depuis les années 70 ainsi que quelques passages dans des concerts rock tout aussi imaginaires. Et dans la foulée, Malcolm et Steven s'invitèrent dans la formation sous les noms respectifs de Solomon St Jermain et de Porcupine Tree. Et sous ce nom, Steven décide de produire deux maquettes (Tarquin's Seaweed Farm -1989 et The Nostalgia Factory -1990) et de les faire parvenir à différents magazines accompagnées de la biographie de IEM. Jusqu'au jour où le label Delerium, emmené par Richard Allen, décide dans un premier temps de sortir les cassettes puis, après que Wilson fut invité à collaborer avec le label en tant que premier artiste, Porcupine Tree fut incité à publier un double album incluant les deux cassettes. Mais Wilson décida en fin de compte de ne garder que les titres qu'il jugeait être les meilleurs pour aboutir à la sortie, au début de l'année 1992, de On the Sunday of Life... Seulement pressé en un millier d'exemplaires, l'album se trouva rapidement en rupture de stock poussant le label à le rééditer rapidement.
 Et alors que la popularité de Porcupine Tree va grandissante et que son autre formation (No-Man) continue d'attirer les éloges de la presse et du public anglais, Steven Wilson saute le pas et quitte son travail pour ne se consacrer plus qu'à sa passion, en profitant de l'occasion pour sortir Voyage 34, toujours en 1992, et composé d'une seule et unique piste de trente minutes retraçant les différentes étapes d'un drogué lors de la prise de LSD. Du fait de la durée du single, le titre ne sera jamais un succès commercial mais sera néanmoins très bien accueilli par le milieu underground anglais, arrivant même à se glisser à la 20ème place des singles indépendants.
Et alors que la popularité de Porcupine Tree va grandissante et que son autre formation (No-Man) continue d'attirer les éloges de la presse et du public anglais, Steven Wilson saute le pas et quitte son travail pour ne se consacrer plus qu'à sa passion, en profitant de l'occasion pour sortir Voyage 34, toujours en 1992, et composé d'une seule et unique piste de trente minutes retraçant les différentes étapes d'un drogué lors de la prise de LSD. Du fait de la durée du single, le titre ne sera jamais un succès commercial mais sera néanmoins très bien accueilli par le milieu underground anglais, arrivant même à se glisser à la 20ème place des singles indépendants. En 1993, Steven Wilson sort Up The Downstairs. A la base prévu pour être un double album, celui-ci se verra amputé de ses pistes les plus expérimentales à la demande du label Delerium (celles-ci sortiront l'année suivante sur l'EP Staircase Infinities). L'album est un véritable succès, considéré notamment par Melody Maker comme « une pièce maîtresse du psychédélique... L'un des albums de l'année. ». Et devant l'accueil réservé au groupe, l'heure était venue de donner réellement corps à Porcupine Tree en vue de fouler les planches. Steven Wilson recrutera dès lors le claviériste Richard Barbieri, ayant participé peu de temps avant à l'aventure No-Man, Colin Edwin à la basse et Chris Maitland à la batterie. Le groupe est alors prêt pour donner ses premières représentations en décembre 1993.
Et le véritable départ discographique de Porcupine Tree en tant que groupe aura lieu deux ans plus tard, en 1995, avec la sortie de The Sky Moves Sideways, album composé en partie encore par Wilson seul mais dont le noyau central et titre éponyme de plus de 35 minutes laisse éclater au grand jour le talent des quatre musiciens. L'album rencontre un énorme succès, certains n'hésitant pas à voir en Porcupine Tree les Pink Floyd des années 90. Ce que Wilson finira par regretter, considérant l'album trop proche du Floyd pour être réellement original.